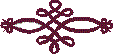CAPSULES HISTORIQUES
|
Le
bois des quatre lieues
C’est le titre d’un roman historique écrit en 1955 par madame Liliane Vien-Beaudet de Saint-Césaire. Elle s’est inspirée selon ses propres dires, de « souvenirs » racontés dans sa famille depuis des générations. Il met en vedettes des ancêtres de l’auteure qui sont deux des premiers habitants de notre région : Léonard Frambes et Thomas Harris. Mais dans les faits qu’en est-il exactement de ce « bois »? Nous avons donc consulté notre historiographie locale pour voir comment les auteurs ont traité ce sujet dans leurs écrits. Disons aussi qu’une lieue = environ 3 milles ou 4 km. Le premier et l’incontournable historien à nous signaler ce bois vous l’avez deviné c’est Isidore Desnoyers, dans son Histoire de la paroisse de Saint-Césaire paru dans le journal Le Commerçant de Saint-Césaire en 1877 et 1878. Il décrit en ces termes le fameux « bois » en question : « En l’année 1800, les rivages de l’Yamaska, aujourd’hui si pittoresques et si champêtres, n’étaient encore couverts que d’arbres séculaires surplombant ses bords. Le rare voyageur qui, par aventure, sillonnait ses ondes calmes et paisibles, ne rencontrait, sur son passage, que cinq habitations, depuis le village actuel de St-Césaire, jusqu’au confluent des deux branches ouest et est de cette rivière, appelée communément la Pointe-aux-Fourches. Voyons plutôt : Si elle existait encore, on verrait près du cimetière la chaumière du père Joseph Fréchet; six arpents plus bas, rive ouest était celle de Pierre Brisset en descendant une lieue, sur la rive est, se trouvait la maisonnette de Joseph Pivin, mort ici, le 14 février 1823, à l’âge de 80 ans; deux lieues en aval de ce dernier, même rive, au pont actuel de St-Damase, habitait le nommé Leroux; enfin un nommé St-Antoine avait aussi sa hutte de logs sur la rive gauche, vis-à-vis Pointe-aux-Fourches. Revenant maintenant sur nos pas et remontant la rivière jusqu’au haut de la paroisse, nous y rencontrons : Soyer à quatre arpents plus haut que le village actuel sur la rive ouest près de deux milles en amont Joseph Daniel dit Gélineau; un mille et demi plus haut encore N…Patelaugh, allemand, à l’emplacement du futur manoir de Rottermund sur la rive est, à 50 arpents du village Léonard Frambes, Thomas Harris et plus haut N.Pulver. Ainsi donc, à cette époque onze habitants étaient établis, depuis les Fourches jusqu’à l’entrée du fameux Bois-des-quatre-lieues, c’est à dire sur un parcours de près de dix-huit milles. Le Bois-des-quatre-lieues, de sinistre et lugubre mémoire, a été longtemps et tristement renommé pour les nombreux méfaits et crimes qui y furent commis. Il commençait à environ trois milles et demi du village de St-Césaire à une grande maison jaune, servant d’hôtellerie, tenue plus tard, par deux Américains, bâtie près du chemin de ligne qui conduit aujourd’hui, au rang des Écossais. » En 1927, l’abbé Paul-M. J. Benoit curé de Saint-Césaire fait paraître un livret intitulé La Caisse Populaire de Saint-Césaire de Rouville. On retrouve à l’intérieur de ce volume, l’historique de la caisse populaire de Saint-Césaire depuis sa fondation en 1917 mais aussi l’histoire de Saint-Césaire basée jusqu’en 1880 sur les écrits de Desnoyers. Le passage touchant le bois des quatre lieues, est presque en tout point, semblable aux écrits de l’historien. Une autre référence que j’ai trouvée concernant le bois des quatre lieues est celle de Mgr C.-P. Choquette dans son Histoire de la ville de Saint-Hyacinthe. À la page 31 de son volume il nous raconte ceci : « C’est probablement en raison de ces paisibles occupations qu’aucun épisode tragique, aucun fait de guerre, aucune escarmouche n’est restée dans l’histoire ou dans la légende concernant le fortin de Saint-Hyacinthe, tandis que la mention de celui de Saint-Césaire – dont les noms de plusieurs occupants ne sont ni français, ni anglais – s’enveloppe du récit d’événements lugubres, de sanglantes tragédies même. En mes jeunes années d’école, j’entendis parler souvent du « blochouse » transformé en hôtellerie, dans la « forêt de quatre lieues » de Farnham, sur la route conduisant, des bords de la rivière Richelieu, à Winooski, à Saint-Albans, à Burlington. Mes petits camarades racontaient comme des traditions familiales issues de générations passées, des histoires à faire dresser les cheveux. Il y était question de coupe-gorge, de trappes par où planchers et lits étaient précipités dans la cave et les occupants dépouillés de leur argent et parfois de la vie.» Plusieurs personnes âgées de Saint-Césaire et des environs m’ont signalé certaines bribes de récits, concernant ce fameux bois, que leurs parents racontaient effectivement lorsqu’ils étaient enfants. Gilles Bachand ©Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
© 2021 Tous droits réservés. Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux. | |||